23 octobre 2025
Contribution de l’UFE au GT AO PPE3 de la DGEC
Évolution des cahiers des charges pour les AO à partir de 2027
L’Union française de l’électricité remercie en premier lieu la DGEC pour l’organisation d’un GT dédié à l’évolution des cahiers des charges pour les AO de la prochaine PPE.
Le développement des énergies renouvelables est essentiel pour répondre à l’électrification des usages et ainsi à l’atteinte de notre souveraineté énergétique. L’UFE accueille très favorablement l’ouverture des futurs AO EnR terrestre à de nouveaux critères hors prix, prenant en compte une contribution à la résilience (ou made in Europe) et le respect des impératifs environnementaux. Elle rappelle cependant en préambule qu’une multiplicité des critères peut être de nature à (i) complexifier les AO et (ii) diluer l’efficacité des objectifs recherchés à travers ces critères.
Intégration des critères NZIA en éligibilité
L’UFE a déjà pu s’exprimer favorablement sur la mise en place de critères NZIA dans le cadre des appels d’offres. L’UFE remercie les pouvoirs publics pour leur volonté de mettre en œuvre rapidement ce règlement, afin de renforcer les chaînes de valeurs industrielles existantes et de concrétiser de nouveaux investissements sur notre territoire, pour renforcer notre souveraineté énergétique.
Dans ce cadre, l’UFE souligne l’urgente nécessité de soutenir les filières industrielles françaises des EnR électriques, mais également des réseaux. Cela permettra de répondre aux enjeux de sécurité d’approvisionnement, de cohésion entre les territoires et de relance économique, pour améliorer in fine la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d’achat des ménages. Pour accompagner cette ambition, nous devons en outre impérativement répondre aux besoins en termes d’emplois et de formations de toute la chaîne de valeur.
Concernant la pondération des critères, l’UFE rappelle que la pondération du critère prix reste élevée pour les AO nationaux : 70 % pour le photovoltaïque au sol, 95 % pour l’éolien terrestre, 70 % pour l’éolien en mer. L’UFE estime que les critères de sélection doivent être soigneusement définis pour permettre de contribuer à la dynamisation des filières.
Dans l’objectif d’atteindre un équilibre entre l’offre de produits et la demande, aussi bien en termes de volume, de prix, que de qualité, plusieurs conditions doivent être garanties pour que les AO intègrent des critères hors-prix sans complexités excessives :
- Les critères doivent être spécifiques à chaque technologie, afin de prendre en compte leurs niveaux de maturités ;
- Les critères doivent être réévalués régulièrement afin de prendre en compte les retours d’expérience, la réalité des investissements observés et de l’évolution de la réindustrialisation européenne. Cette précaution doit permettre d’éviter de fixer des critères trop ambitieux trop tôt, ce qui risquerait de freiner le développement des installations par manque d’offres d’équipements français &/ou européens ;
- Une clause de sortie, telle que prévue par le règlement NZIA, doit être prévue dans les cahiers des charges pour s’assurer à 6 mois de la FID de la disponibilité de la supply chain, conformément à l’article 26.5 du règlement NZIA ;
- Une seconde clause de sortie, telle que prévue le règlement NZIA, doit également être prévue dans les cahiers des charges en cas d’augmentation disproportionnée (+15%) du coût du projet du fait de l’intégration des critères non-prix, afin de ne pas compromettre la compétitivité des projets et de renchérir démesurément le coût de l’énergie produite, conformément à l’article 26.5 du règlement NZIA ;
- Le poids de la notation de chaque critère des Appels d’Offres (AO) devra refléter les surcoûts liés à la différence de compétitivité induite par ces nouveaux critères (en relevant si nécessaire les prix plafonds, selon une méthode transparente pour les participants), pour que développeurs et industriels puissent s’engager dans des logiques de contrats de long terme avec des industriels et équipementiers européens ;
- Une révision régulière des prix plafonds doit être menée, prenant en compte notamment le coût des technologies.
Vous semble-t-il pertinent de prévoir des critères NZIA pour l’AO éolien terrestre ?
L’UFE estime que l’application de critères NZIA à l’éolien terrestre impose l’utilisation de composants ne venant pas de Chine. Il importe donc d’obtenir des précisions des turbiniers sur les difficultés d’application du NZIA. En l’absence d’informations précises il est préférable selon l’UFE de ne pas mettre le critère de résilience en éligibilité et de préférer un critère de notation dans un premier temps, afin de permettre aux porteurs de projets de candidater aux AO si jamais les installations ne respectent pas le critère de résilience tel que défini dans le règlement NZIA. L’UFE suggère alors de ne pas dépasser le volume de 30% requis à ce stade toute technologie confondue. Cela milite pour une application des critères NZIA pour l’éolien terrestre sur un pourcentage réduit des AO. L’UFE rappelle également que le poids de la notation du critère de ces AO devra refléter les surcoûts liés à la différence de compétitivité induite par ces nouveaux critères en relevant les prix plafonds.
Que pensez-vous de ces critères, et de leur utilisation en éligibilité ? Quel seuil vous semble pertinent pour l’empreinte carbone ?
Les critères doivent être clairement définis, simples à quantifier et à mettre en œuvre. L’UFE soutient une approche progressive et itérative dans la mise en œuvre du NZIA, afin de ne pas entraver le développement du made in Europe et soutenir la réindustrialisation. L’UFE souligne également que seuls des appels d’offres attribués dans les temps et sans contentieux liés à l’attribution des AO permettront de développer l’industrie française et européenne.
Critères NZIA :
- Conduite responsable des entreprises
- Détails : Répondre aux exigences fixées par le cahier des charges en la matière, notamment en prenant des mesures tenant compte du devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement et en communiquant publiquement sur cette conduite responsable.
- Recommandation de l’UFE : Critère déjà mature qui devrait être un critère d’éligibilité. Obligation de publication d’un rapport extra-financier, ou du Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) comme le prévoit la directive européenne.
- Cybersécurité et sécurité des données
- Détails : Le candidat devra fournir ou s’engager à fournir un plan, relatif au projet candidat, en matière de cybersécurité et de sécurité des données dès la conception dans le but de garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information de l’installation photovoltaïque. Il devra également s’assurer que ses fournisseurs pour les produits TIC prennent ces mesures. Il devra enfin s’assurer que le contrôle opérationnel de l’installation soit exercé par un opérateur établi dans l’espace économie européen.
- Recommandation de l’UFE : Critère déjà mature qui devrait être un critère d’éligibilité, essentiellement via le respect de la directive NIS 2. L’UFE note, à ce stade, qu’un principe de proportionnalité devrait s’appliquer pour les plus petits acteurs. Ce critère devrait être mis en place dans un second temps avec une mise en application progressive après la transcription de la Directive NIS 2 prévu avant le 17 octobre 2024. Il conviendra de s’assurer que ce critère n’impose pas de contraintes déraisonnables sur certains composants, essentiellement fabriqués en Asie lorsque la chaine de valeur n’existe pas en France & en Europe. Ce critère devra être étudié avec les équipementiers (éolien, onduleur, …) et adapté en fonction de la réalité du terrain. D’autres actions pourront être possibles (certification par l’ANSSI, réalisation de télémaintenance au sein de l’UE et stockage des données).
- Capacité à réaliser le projet dans son intégralité
- Détails : Le candidat devra fournir les éléments permettant de l’identifier (extrait de Kbis), une autorisation d’urbanisme et une description du projet (= dossier de candidature).
- Recommandation de l’UFE : Critère d’éligibilité déjà prévu dans le cahier des charges.
- Résilience :
- Détails : Les offres devront prévoir des installations photovoltaïques réalisées avec au moins 4 composants principaux résilients (parmi lesquels obligatoirement les cellules, les modules et l’onduleur). Le 4e composant résilient est laissé au choix du candidat parmi : wafers, lingots, polysilicium, verre solaire, et tracker (le cas échéant).
- Recommandation de l’UFE : Critère qui devrait être en notation. En effet, l’application du NZIA sous la forme de critères d’éligibilité et non de notation risquerait d’entraîner un nouveau renchérissement de projets PV déjà rendus artificiellement particulièrement onéreux. L’UFE recommande de commencer via une période de transition (3 premiers AO) avec un critère de notation combiné avec un critère « made in Europe » afin de garantir que les critères NZIA contribuent au développement des giga factories. L’UFE préconise ensuite de basculer le critère en éligibilité une fois les filières industrielles résilientes en mesure de fournir dans des volumes et délais cohérents avec le marché. Leur contrôle serait réalisé dans le certificat de conformité. En outre, appliquer le NZIA dans un premier temps à tout ou partie des volumes PV Bâtiments appelés (y compris via l’AOS) faciliterait la gestion des surcoûts associés au sourcing en panneaux résilients et permettrait d’accompagner la montée en charge progressive des industriels français et européens, qui ne sont vraisemblablement pas prêts à date. Il convient enfin de prévoir une clause de sortie en cas de coûts disproportionnés.
- Durabilité environnementale :
- Détails : Critère de recyclabilité détaillé dans le cahier des charges basé sur : i) un % minimal de masse recyclable ; ii) une prise en compte des éléments perturbateurs à la récupération des matériaux critiques
- Recommandation de l’UFE : Critère qui devrait être en éligibilité. Ce critère serait relatif au taux de recours aux matériaux recyclés et/ou un critère relatif au taux de recyclage ou de réutilisation. Cet aspect constitue d’ores et déjà un enjeu de différenciation fort des fabricants français de panneaux photovoltaïques et éoliens par rapport à la concurrence asiatique et devrait donc être intégré parmi les critères de notation à court terme, sans préjuger cependant de la pertinence de ce critère sur le long terme dès lors que les fabricants asiatiques ont une forte capacité d’adaptation industrielle. Privilégier le recours aux matériaux recyclés d’origine française ou européenne (par exemple via un label) permettrait d’accélérer le développement de l’économie circulaire tout en réduisant les importations et ainsi de limiter le déficit commercial. Un critère hors prix de part de réincorporation d’éléments recyclés, notamment les minéraux critiques (terres rares issues des aimants permanents), permettrait de favoriser le développement de maillons de la chaîne industrielle du recyclage des technologies. L’UFE attend ainsi du gouvernement un soutien des initiatives et investissements industriels relatifs au recyclage des installations éoliennes. Ce critère de part de réincorporation d’éléments recyclés doit être défini sur ce qui est faisable au moment du lancement de l’appel d’offres, et non sur ce qui est extrapolé, afin de permettre aux développeurs de s’engager de manière réaliste.
Que pensez-vous du calendrier de mise en place de ce critère par rapport au volume de production de panneaux respectant ce critère ?
L’UFE appelle à plus de transparence sur la mise en service des usines de fabrication, afin de suivre la montée en puissance des industriels français et européens (notamment sur le solaire). Ces critères, afin d’être bien calibrés et alignés avec la réalité industrielle et de permettre une courbe d’apprentissage pour les candidats, devraient être appliqués uniquement à partir des AO PPE3.
Évolution des critères de notation
Que pensez-vous des pistes d’évolution des critères de notation visant à i) renforcer le poids du critère carbone (le cas échéant, quelle valeur vous semblerait pertinente pour l’écart entre Pinf et Psup ?) ou ii) introduire un critère de notation portant sur la contribution à la résilience ou un critère de notation “made in Europe”, tout en remplacent le critère de notation sur l’emprunte carbone par un plafond en éligibilité et/ou supprimer les autres critères de notation hors prix (aspect participatif et CAS 3 dans l’AO PV) ? Quelles filières devraient, selon vous, êtres concernées par ces critères de notation ?
Concernant les AO PV, l’UFE serait favorable à un critère portant sur la contribution à la résilience, si possible par un critère “made in Europe”, sous réserve d’une acceptation par la Commission Européenne. En effet, des mesures de bonus ont déjà pu être mis en place pour des fabrications européennes, comme le bonus automobile. Le critère de notation carbone serait alors maintenu à son niveau actuel, sans nécessiter d’en renforcer le poids. L’UFE est favorable à une évolution du calcul Prix inférieur sur le modèle : « Pinf = Psup – 50 ».
À défaut de l’ensemble des critères NZIA, l’éolien terrestre pourrait intégrer un critère des critères NZIA ou du « made in Europe » dans ses AO, après étude sur le risque de hausse de coût des projets et sur la capacité d’approvisionnement en Europe.
L’UFE suggère en outre d’introduire ce critère via un AO dédié « NZIA » dont les volumes pourraient évoluer à la hausse le temps que les filières industrielles s’adaptent, tant en éolien qu’en PV. Dans le même temps, les volumes « classiques » pourraient quant à eux évoluer graduellement à la baisse. L’AO neutre pourrait alors devenir un «AO NZIA » par exemple.
Dans ce contexte, le plus équitable semble d’avoir i) un AO NZIA réservé pour avoir une compétition équilibrée, ou ii) des volumes réservés (éventuellement évolutifs au cours du temps) pour privilégier dans un AO une part de projets identifiés dans ce sens (avec prix et plafond réhaussé).
Suppression des CETI dans l’appel d’offres PV sol
Que pensez-vous de ces évolutions ?
L’UFE serait favorable à supprimer entièrement les cas 1, cas 2 et cas 2 bis en rendant simplement éligibles les projets PV disposant d’une autorisation d’urbanisme valide.
Néanmoins, l’UFE souligne que la suppression des CETI supprimerait par définition les projets en sites dégradés. Bien que le gisement se réduit, il reste à court-terme conséquent et certains projets sont toujours en cours de développement, avec d’ores et déjà des accords contractuels basés sur le bonus anticipé. L’UFE rappelle les externalités positives permises par le dispositif du cas 3, tel que la dépollution des sols et la réutilisation de terrains dégradés inexploitables par ailleurs. Ainsi, l’UFE appelle à maintenir les cas 3 (via un bonus) mais en donnant une visibilité, le cas échéant, sur la fin de ce cas aux acteurs pour leur permettre d’anticiper la fin de ce régime. La suppression de ce cas permettrait de diminuer la pression sur certains fonciers, réduisant de fait le coût des projets lauréats.
En complément des autres évolutions 2025/2026 évoquées, l’UFE est favorable à l’ensemble des évolutions. Sur le même principe que les zones humides, l’UFE appelle à supprimer la mention relative au tout boisement « l’engament à ne pas détruire de mare, haie ou bosquet pour installer ou exploiter le projet » dans le cahier des charges, puisque cette composante est déjà encadrée dans l’autorisation environnementale.
Comment traiter dans ce cas les projets agriPV pré-APER ? Y aura-t-il encore des projets agriPV pré-APER candidats à compter de 2027 ? Quid d’exclure de l’éligibilité aux AO les projets pré-APER ?
Concernant les projets pré-APER, il est important de conserver la possibilité pour le stock de projets pré-APER à participer au Cas 2bis des AO. Ainsi, l’UFE propose de maintenir les CETI uniquement pour le Cas 3 et le Cas 2bis pré-APER. Pour continuer à faire sortir les cas 3, il est en effet important en transition de ne pas totalement déplafonner le cas 2 bis mais d’augmenter simplement le volume appelé. Un plafond à 500 MWc pour les périodes à venir semblerait pertinent dans ce sens.
Valorisation des projets situés dans les zones d’accélération des énergies renouvelables
Comment valoriser les projets situés dans les ZAER dans les AO à partir de 2027 ?
Bonus de notation ? Le cas échéant, critère de notation dédié, ou critère groupé avec l’aspect participatif et/ou la localisation en lien avec la capacité de raccordement – cf slide suivante ? Le cas échéant, comment ce critère groupé devrait-il être construit selon vous ?
Éligibilité ? Le cas échéant, sur une période dédiée ? dans un appel d’offre dédié ? Par un volume réservé dans les AO classiques ?
Autres idées ?
L’UFE souhaite rappeler en premier lieu que, conformément à l’article 17 de la loi APER, l’implantation dans une ZAER ou la modulation tarifaire ne doit en aucun cas avoir un effet discriminatoire. Or, l’inclusion de critères basés sur la localisation des projets dans ces zones au sein des AO contreviendrait à ce principe.
En effet, les travaux visant à définir et à finaliser les ZAER ne sont pas encore achevés, et leur finalisation pourrait prendre encore un délai difficile à déterminer. En date du 10 septembre 2025, seulement 40 % des communes avaient défini au moins une zone sur le portail cartographique. De plus des disparités entre les différentes technologies d’ENR sont encore marquées : 45 % de la surface est dédiée à la filière photovoltaïque (mais seulement 3% au solaire au sol), contre seulement 2,3 % pour l’éolien terrestre et 3 % pour l’hydroélectricité. L’UFE souligne également que la définition d’une ZAER ne garantit pas nécessairement la capacité suffisante sur le réseau électrique ni la disponibilité des terrains nécessaires à l’implantation des projets. La prise en compte des ZAER risque donc de favoriser le développement de projets dans des zones disposant d’une capacité d’accueil déjà limitée.
Par conséquent, ces zones ne peuvent pas garantir la faisabilité des projets et leur utilisation dans les AO pourrait créer des distorsions entre les technologies, mais aussi entre les régions.
L’UFE est donc opposée à l’intégration d’un critère d’éligibilité, du fait de son effet discriminatoire envers les territoires n’ayant pas finalisé l’identification des ZAER. Les ZAER s’inscrivent dans une volonté d’accélérer le développement des projets EnR et non d’exercer une contrainte sur les projets en dehors de ces zones. Le bonus de notation apparait enfin peu adapté car il viendrait potentiellement renchérir le coût des projets sans cibler des retombées pour les communes.
Les ZAER ont été pensées pour marquer la volonté locale de développer les ENR et d’accélérer leur déploiement. Le développement d’un projet dans une ZAER permet en effet d’éviter la mise en place d’un comité de projet. Ces zones sont ainsi d’ores et déjà un critère implicite dans les AO selon l’UFE, et une valorisation explicite des ZAER dans les AO des critères d’éligibilité introduirait une dénaturation de l’objectif initial de ces zones. De plus la valorisation de ces zones dans les AO aurait pour effet d’augmenter artificiellement leur valeur, alors qu’elles n’apportent dans les faits aucune plus-value pour le système électrique.
L’UFE recommande toutefois de valoriser les ZAER par une modulation de la répartition de l’IFER entre l’échelon communal et départemental pour les communes concernées. L’UFE suggère une réhausse de la part de l’IFER dédiée aux communes d’accueil de 5% pour les parcs en ZAER, soustrait de la part départementale.
L’UFE propose également une instruction accélérée des projets en ZAER, permise par un renfort des ressources humaines pour l’instruction de ces dossiers. Les DREAL disposeraient d’un délai de 6 mois pour leurs instructions.
Enfin, l’effet des ZAER sur le développement des projets ne pourra être observé que dans plusieurs années. L’UFE suggère de prévoir un suivi des projets effectivement inclus dans les ZAER dans les indicateurs de suivi prévu par la loi APER. Ce suivi plus fin permettra d’établir un premier retour d’expérience avant toute conclusion sur la pertinence d’une éventuelle valorisation dans les AO des projets en ZAER.
Dispositions sur la capacité/le délai de raccordement
Que pensez-vous de l’introduction de disposition incitant à favoriser les projets situés dans les zones où le raccordement est le plus rapide / où les capacités de raccordement sont disponibles immédiatement ou à court terme ?
Identifiez-vous d’autres manières d’introduire des incitations relatives aux délais/capacités de raccordement dans les appels d’offres ?
Afin de répondre à ces questions, l’UFE estime qu’il est impératif de clarifier les problématiques sous-jacentes et les moyens (existants ou non) qui permettraient de les traiter.
La principale problématique constatée actuellement par les gestionnaires de réseau est une saturation de certaines zones générant des délais de raccordement importants, pouvant entrainer des impossibilités de transmission de proposition technique et financière (PTF). L’UFE précise que toute proposition visant à traiter cette problématique de court-moyen terme doit s’articuler avec les travaux en cours sur la planification de long terme du réseau dans le cadre des S3RENR, qui restent l’un des outils pour traiter le sujet.
L’introduction de critères incitant à favoriser ou rendre éligible les projets sur la base des délais de raccordement indiqués par les gestionnaires de réseau dans les PTF transmises par les gestionnaires de réseau, avant l’ouverture de l’AO nous semble à proscrire. En effet ce mode de fonctionnement implique également un risque pour le porteur de projet de (i) voir les délais annoncés varier et (ii) de subir des coûts échoués lorsque la PTF arrive à expiration. La condition sine qua non de demande de PTF pour tous les candidats (qu’ils soient in fine lauréats ou non) implique inévitablement une surcharge de travail artificielle pour les gestionnaires de réseau.
Si l’UFE estime que le critère NZIA est un critère prioritaire dans le cadre des futurs AO de la PPE 3, les problématiques de saturation des zones doivent toutefois être solutionnées. L’UFE souligne qu’une multiplicité de critères de notation nécessitera une réflexion sur la pondération des critères pour préserver leurs effets incitatifs. Des échanges sont alors nécessaires pour identifier collectivement des pistes de court terme pour limiter les afflux de projets dans des zones déjà identifiées comme congestionnées, notamment par l’intermédiaire de nouvelles cartographies travaillées collectivement par les GRD et RTE prenant en compte la capacité du réseau actuelle et future.
L’UFE note enfin que les problématiques de saturation sur le RPD nécessitent souvent la construction d’un poste source, ou la création d’un raccordement supplémentaire avec le RPT, afin de décongestionner le réseau aval. Une meilleure répartition de l’IFER sur les transformateurs électriques — par exemple selon une clé 50/50 entre les communes et les EPCI — constituerait une première piste d’action. En effet, lorsque la commune concernée appartient à un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la totalité de cette IFER est aujourd’hui perçue par l’EPCI. En France, toutes les communes sont rattachées à un EPCI à fiscalité propre. D’après les données de data.gouv, on en dénombre 1 254, dont 1 094 relèvent du régime de la FPU, soit 87 % du total. Autrement dit, la grande majorité des communes appartiennent à une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique. Ainsi, les gestionnaires de réseau rencontrent des difficultés à convaincre les élus communaux de l’intérêt d’accueillir de nouveaux postes source, dans la mesure où leur commune n’en retire aucune retombée économique directe.
Évolutions du complément de rémunération
Concernant la prime de performance annuelle, que pensez-vous des ajouts proposés ? Comment calibrer les paramètres de la prime, et en particulier le montant (P) pour qu’il permette des incitations efficaces (variation du productible et de la réplicabilité du M0) ?
La prime proposée serait-elle efficace pour répondre à l’effet incitatif recherché ?
Identifiez-vous des effets de bords négatifs de cette prime ? Concentration géographique des projets selon les filières, bonification facilitée des projets déjà développés etc ?
L’UFE estime que les installations sont déjà naturellement incitées à produire lors des mois où les M0 sont les plus élevés, une prime de performance parait alors difficilement justifiable.
L’UFE comprend que cette prime envisagée par la CRE est destinée à introduire une incitation à optimiser le profil de production saisonnier. L’UFE souhaite souligner que cette option peut créer des effets de bords. En effet, le niveau de la prime P (borne de +/- 4 €/MWh évoquée) pourrait influencer les stratégies des producteurs au moment de la candidature aux appels d’offres. D’ailleurs, l’imprécision de la prime ainsi que son application incertaine et potentiellement couteuse compliqueront la détermination du prix d’offre et inciteront les acteurs à couvrir le risque de malus. S’agissant des dates de planification des maintenances, l’UFE souligne que l’introduction d’une prime de performance peut (i) concentrer les demandes d’intervention sur une période plus courte, risquant ainsi de saturer les capacités d’intervention des mainteneurs et (ii) entraîner une augmentation des prix des interventions, les mainteneurs pouvant chercher à obtenir une part de la prime.
L’UFE appelle donc à ne pas introduire de prime de performance, afin de ne pas complexifier le mécanisme de rémunération au M0. L’UFE rappelle également que les programmes de maintenance devront s’étaler sur toute l’année pour répondre aux contraintes humaines de disponibilités des effectifs des techniciens.
Que pensez-vous de l’intégration d’une prime de gestion ? Comment la prime de gestion devrait-elle être calculée selon vous ?
L’UFE est favorable à cette introduction d’une prime de gestion proportionnelle au M0. Cette évolution pourrait permettre de mitiger la forte préférence des exploitants pour les contrats d’agrégation à frais fixes, une part des coûts variables d’équilibrage serait couverte par le contrat. Une analyse de la CRE serait souhaitable sur l’indicateur de référence à retenir. En effet, une prime proportionnelle au prix moyen des écarts pourrait être plus représentative des coûts subits par les producteurs. Comme pour les projets en DCCR17, cette prime de gestion serait traitée distinctement du prix moyen des AO.
Que pensez-vous d’un calcul du CR sur la d’un volume de production normatif ? Le cas échéant, comment ce volume de production normatif devrait-il être calculé selon vous ?
L’UFE ne se prononce pas à ce stade, les différentes méthodes pouvant être envisagées soulevant encore des questionnements sur leurs implémentations, qu’il convient de traiter collectivement. L’UFE se prononcera ultérieurement sur cette question.
Que pensez-vous d’une proposition visant à introduire un coefficient Alpha ? Le cas échéant, quelle forme et quelle valeur devrait prendre ce coefficient, selon vous ?
Selon l’UFE, l’introduction d’un coefficient alpha dans les contrats de complément de rémunération devrait être introduit à la condition qu’il soit paramétré de manière stable, transparente et cohérente avec le profil d’amortissement des projets. Ce mécanisme, qui majore le tarif en début de contrat puis le réduit en fin de période, répond directement aux exigences des financeurs : il renforce la capacité de remboursement lorsque la dette pèse le plus, réduit le risque de défaut et améliore les conditions de financement, sans surcoût moyen pour la puissance publique. Pour la filière hydroélectrique, souvent contrainte par des plafonds de prix en appel d’offres, l’alpha permet d’équilibrer la trésorerie et de rendre finançables des projets viables sur le long terme. L’UFE recommande donc de généraliser ce dispositif dans les appels d’offres dédié à la filière hydroélectrique et de le calibrer pour que la majoration initiale reflète la réalité du service de la dette (par exemple +10 % à +15 % les premières années), avec une courbe d’évolution fixée dès la signature du contrat.
L’UFE est en revanche en défaveur de l’application de cette proposition aux autres filières, considérant le peu de gains sur le coût du financement des projets et la complexité induite dans les AO. De plus, l’introduction d’un tel coefficient aux filières viendrait augmenter mécaniquement les CSPE à court-terme, ce qui semble particulièrement dommageable pour le budget de l’Etat dans les conditions actuelles et comportent un risque majeur de désinformation sur les causes expliquant cette augmentation à court-terme des CSPE.
Que pensez-vous d’une proposition visant à réévaluer les paramètres permettant de calculer les coefficients K et L ? Le cas échéant, comment les formules et paramètres de calcul des coefficients K et L devraient-elles évoluer, selon vous ?
L’UFE ne se prononce pas.
Que pensez-vous d’introduire le principe d’une évolution possible des coefficients K et L en cours de contrat en fonction de la réalité de l’évolution des coûts évaluée par la CRE ? Quel effet cela aurait-il sur les tarifs de référence demandés par les candidats aux AO ?
L’UFE est défavorable à cette proposition. Il est en effet nécessaire, après conclusion des contrats de soutien aux énergies renouvelables et après bouclage du financement des projets, d’éviter toute modification remettant en cause l’équilibre économique des projets. Dans le cas contraire, de telles modifications pourraient entraîner des renégociations de documentations bancaires, voire des défauts, et d’augmenter le risque perçu par les banques et les investisseurs pour les futurs projets, et ainsi surenchérir le coût de financement de ces derniers et in fine de dégrader leur compétitivité.
Que pensez-vous des propositions issues du rapport de la CRE, consistant en une uniformisation de la franchise à 30h et un meilleur calibrage de la prime (3 alternatives envisagées) ?
Le document de la CRE propose de maintenir une franchise d’heures pour le versement de la prime Pnég et de l’uniformiser à 30 heures dans le cas général. Concernant la franchise d’heures de prix négatifs, actuellement fixé à 15h pour le solaire, 20 heures pour l’éolien terrestre et 70h pour l’hydroélectricité, l’UFE appelle à ce que la compensation financière pour les nouveaux contrats de CR puisse être effective dès la première occurrence de notification d’arrêt pour prix négatif. En effet, il est important de rappeler que l’existence d’une telle franchise accroît les risques des 3 producteurs, qui doivent estimer le nombre annuel d’heures au cours desquelles les prix spot seront négatifs sur la durée de leur contrat et, partant, l’espérance de perte de revenus subséquente, ce qui induit un renchérissement du niveau des tarifs de référence proposés par les candidats aux appels d’offres et in fine un renchérissement du coût pour l’Etat du soutien des installations de production à partir d’énergies renouvelables. Une meilleure option selon l’UFE consisterait à supprimer cette franchise d’heures et à prévoir un versement de la prime Pnég dès la première heure de prix spot négatif. A défaut, si une franchise devait malgré tout être maintenue, l’UFE accueille favorablement la proposition de la CRE d’uniformiser la franchise pour toutes les filières, mais appelle à l’uniformiser au plus petit dénominateur commun soit les 15 heures de la filière solaire.
À propos du calibrage de la perte de production à compenser en cas de prix spot négatifs, l’UFE est favorable à la mise en place de coefficients normatifs représentatifs des facteurs de charge des différentes filières. Cependant, l’UFE comprend que la CRE souhaite disposer d’une méthode d’évaluation de la perte de production plus précise qu’un facteur de charge normatif afin d’être le plus proche possible du potentiel de production de l’installation lors des heures de prix négatifs.
S’agissant de l’option 1 (estimation basée sur la production du parc sous OA), l’UFE souligne que si les installations sous OA n’avaient jusqu’à aujourd’hui pas d’incitation à stopper leur production lors des prix négatifs, l’article 175 de la loi de Finances introduit la possibilité pour l’acheteur obligé d’arrêter ou de réduire la production des installations supérieures à 10 MW, les retirant dès lors du périmètre de comparaison. Par ailleurs, les installations sous OA inférieures à 10 MW qui continueront à produire lors des occurrences de prix négatifs et resteraient donc dans le périmètre de comparaison seront très différentes des installations sous CR en raison de l’âge des installations (installations sous OA anciennes), du type d’installations et du modèle d’affaires (petites installations solaires en toiture, souvent en autoconsommation côté OA).
Pour l’éolien terrestre, l’option d’estimation basée sur une méthode dite des trapèzes ne semble pas adaptée et mériterait une analyse plus approfondie, compte tenu notamment du fait que, comme le soulignait la CRE dans sa consultation sur l’adaptation du CR au passage pas 15 minutes sur le marché journalier, les heures de prix négatifs sont très rarement isolées (seulement 4% des heures négatives entre 2018 et 2024). Elle suppose par ailleurs que les gestionnaires de réseaux, détenteurs des courbes de charge, réalisent les calculs d’énergie théorique issus du « trapèze ».
Par conséquent, l’UFE est favorable à l’option 2 (estimation dynamique des facteurs de charge de toutes les installations situées dans une même zone géographique à partir uniquement des données météorologiques) qu’elle avait proposé dans sa réponse à réaction aux recommandations de la CRE. L’UFE souligne toutefois la nécessité de trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la méthode et la nécessaire stabilité pour les producteurs et le co-contractant CR, et invite ainsi la CRE à limiter cette mise à jour du coefficient à une fois par an.
Optimiser le soutien par l’AO neutre
L’UFE comprend l’objectif recherché d’abaissement du prix global du soutien aux EnR terrestres à travers un plus grand volume fléché vers l’AO neutre. Toutefois si l’augmentation du volume de l’AO neutre pouvait théoriquement avoir un impact positif en matière de compétitivité et d’atteinte des objectifs de développement, l’UFE identifie un risque en matière d’équitabilité entre les filières. Le PV pourrait en effet bénéficier rapidement de cette évolution, au détriment de l’éolien terrestre et surtout de l’hydroélectricité, résultant en un potentiel frein au développement de ces deux filières.
Par ailleurs, il faudrait que ces volumes soit cohérent par rapport aux volumes prévues pour la PPE2. Finalement, l’économie de soutien serait ainsi nulle puisque ces projets auraient pu être retenus via les appels d’offres dédiés.
L’UFE recommande alors un maintien à l’identique de l’AO neutre pour conserver un rythme de développement optimal de projets qualitatifs.
Dans les AO PPE2, chaque filière a un M0 différent dans l’AO neutre. En cohérence avec la recommandation de la CRE dans son rapport sur le complément de rémunération, se pose également la question de faire évoluer les M0 dans l’AO neutre vers un M0 unique et non pondéré pour toutes les filières. Qu’en pensez-vous ?
L’UFE est défavorable à cette proposition. Des installations aux caractéristiques différentes auront nécessairement des M0 différents, alors même que les trajectoires de substitutions des énergies fossiles par de l’électricité et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoient un développement de toutes les filières électriques renouvelables afin de foisonner les sources d’énergie à notre disposition et améliorer notre résilience via la diversification notre approvisionnement en électricité. Il n’est donc pas pertinent de comparer des filières sur la base d’un même M0.
Une notation basée exclusivement sur le prix et commune à toutes les filières pourrait également être envisagée dans l’AO neutre. Qu’en pensez-vous ?
L’UFE est défavorable à cette proposition car elle réduirait totalement la valorisation des critères hors-prix qui sont nécessaires pour atteindre d’autres objectifs de politiques publiques. Une telle proposition porte notamment un risque de dévoyer les dispositions NZIA, spécifiquement la mise en place du critère de résilience, qui entraînera un surenchérissement des prix proposés aux AO.
Projets hybrides incluant du stockage
Que pensez-vous des propositions ? Quel serait l’effet de cette compensation partielle sur le tarif qui pourrait être proposé par des projets PV sans stockage ?
À quelle échéance cette expérimentation pourrait-elle être lancée afin notamment de permettre un délai suffisant pour reconfigurer des projets existants et y prévoir du stockage ?
Quel volume devrait être concerné ?
Cette modification devrait elle s’accompagner d’autres modifications du cahier des charges ?
Est-ce qu’un appel d’offres dédié ou un volume réservé vous semble préférable et pour quelles raisons ? Quel volume devrait être concerné le cas échéant ?
L’évolution de la condition pour bénéficier de la prime prix négatifs (introduite dans l’AOS) est-elle suffisante pour permettre le développement de projets hybrides ?
De manière générale, quels sont les facteurs expliquant selon vous le faible développement des projets hybrides ? (économiques, réglementaires, design mécanisme de soutien, etc.).
Quelles modifications du cahier des charges proposez-vous pour assurer l’absence de barrières au développement et donner plus d’espace économique des projets hybrides dans les futurs appels d’offres ?
Concernant la proposition de la CRE sur la mise en œuvre d’un appel d’offres expérimental visant à « diminuer l’exposition du budget de l’État à la survenance des prix négatifs et d’apprécier l’effet d’une diminution de cette compensation sur les tarifs proposés par les projets photovoltaïques sans stockage qui se présenteraient à cet appel d’offres », l’UFE ne se prononce pas.
Autres évolutions
Allonger ou raccourcir la durée des contrats de soutien : 15 ou 25 ans au lieu de 20 ans
Pour encourager la baisse de prix de la production d’électricité renouvelables, l’UFE est favorable à une augmentation de la durée des contrats de soutien à 25 ans. En revanche l’UFE n’est pas favorable à un raccourcissement de la durée des contrats à 15 ans.
Clarifier la possibilité et les conditions (notamment les éventuelles pénalités) pour qu’une installation lauréate parte en PPA après son achèvement, en abandonnant son droit au contrat de soutien
L’UFE est favorable à cette clarification. Il n’est en effet aujourd’hui pas justifié d’appliquer des pénalités de résiliation du contrat de soutien dès lors qu’il n’est pas le fruit d’un arbitrage opportuniste et qu’il permet à l’Etat d’économiser des CSPE.
Afin d’assurer un équilibre entre le risque d’opportunismes en cas de prix élevé sur le marché de l’électricité et la sécurisation de l’investissement, l’UFE recommande que le texte lié à la pénalité des sorties anticipées soit ajusté autour de plusieurs principes fondamentaux, notamment :
- Instaurer un plafonnement clair, proportionné et juridiquement garanti du montant de l’indemnité ;
- Exclure toute forme de rétroactivité, en limitant l’application du décret aux futurs cahiers des charges publiés par la CRE.
Suppression des volumes réservés aux projets <1MWc dans l’AO PV bâtiment et <5MWc dans l’AO PV sol
L’UFE ne se prononce pas.
AO petite hydro : Intégration d’un soutien aux projets de rénovation
L’UFE est favorable.
Autres évolutions à apporter aux cahiers des charges ?
Évolutions des AO PPE2 prévues fin 2025 / en 2026
L’UFE suggère d’introduire dès les prochains AO PPE2 une augmentation des durées de soutien à 25 années, ainsi qu’une augmentation du taux d’indexation des contrats sur l’inflation à hauteur de 40% (coefficient L).
L’UFE serait également favorable à supprimer la contrainte de puissance maximale éligible de 30 MWc pour les cas 1, 2 et 2 bis des AO PV au sol. L’UFE propose aussi de ne pas contraindre le producteur à proposer une puissance identique à celle de ses autorisations car cela limite l’optimisation du LCOE qui accompagne l’évolution des technologies. La garantie financière permettrait de contraindre les producteurs à faire preuve de prudence dans leurs choix.
L’UFE suggère enfin de prévoir un bonus pour les petits gabarits éoliens qui ne seront pas compétitifs sans soutien et risqueraient d’être démantelés.
Concernant les AO PV, requérir le certificat ISO à la mise en service de l’installation plutôt qu’à la candidature
L’UFE y est favorable, estimant que cette proposition permet de décharger la CRE au moment de l’instruction.
Concernant les AO PV, réintroduire la clause soumettant à l’autorisation du Préfet le changement de fabricant des PV
L’UFE est défavorable à cette mesure, qui introduirait une rigidité supplémentaire inutile, alors que la flexibilité dans le choix des fabricants est essentielle pour faire face aux aléas de marché, de disponibilité et de prix. Elle pourrait fragiliser la compétitivité et la faisabilité de certains projets, sans réel bénéfice en termes de qualité ou de sécurité. Cette proposition est une complexification du cahier des charges des AO n’apportant aucun bénéfice selon l’UFE, et est donc contreproductive.
L’UFE rappelle également que l’engagement principal du producteur est de respecter l’ECS, et le bureau de contrôle délivrant l’Attestation de contrôle joue déjà ce rôle de validation.
Par ailleurs, la déclaration de changement de fabricant de PV se fait aujourd’hui sur le site Potentiel, et fait également l’objet d’une vérification du Bureau de contrôle. Le suivi par l’administration du changement de fabricants de module PV est ainsi rendu possible.


Contribution de l'UFE au GT AO PPE3 de la DGEC
pdf (400,09 Ko)
22 décembre 2025
Plan d’électrification des usages de l’UFE
L'observatoire de l’industrie électrique en parle
observatoire-electrique.fr

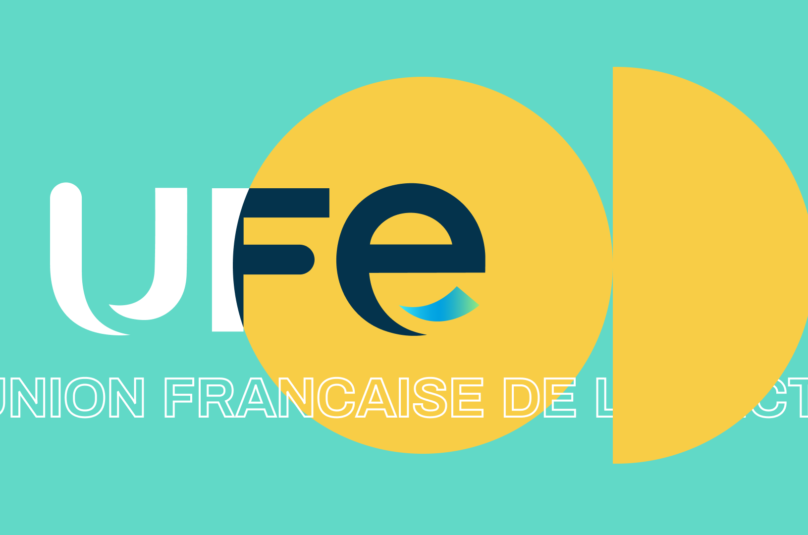
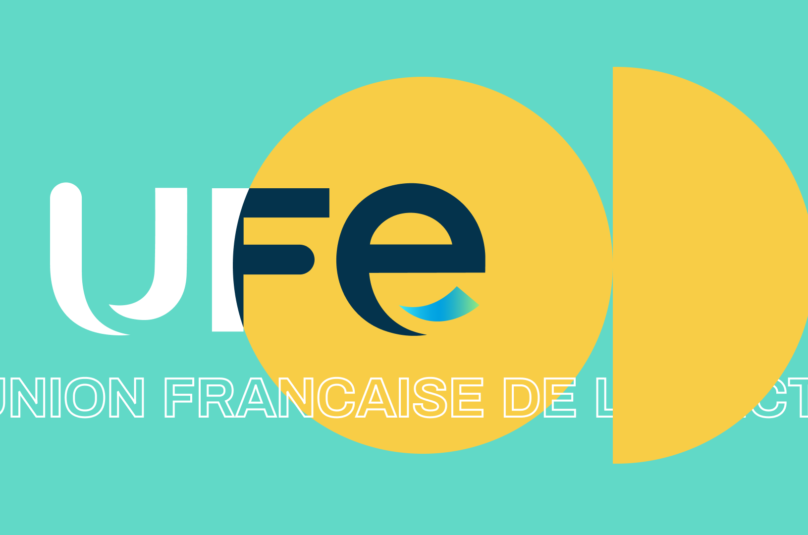
Présentation de l'UFE
L’Union Française de l’Électricité est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle représente les entreprises de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur électrique français : producteurs de toutes technologies, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’électricité et de services d’efficacité énergétique, en passant par les opérateurs de stockage et du pilotage des consommations.
en savoir +Evènements du secteur






Colloque UFE


Colloque 2026
Colloque de l’Union Française de l’Électricité
Le mardi 23 juin 2026 se tiendra la 14ème édition du Colloque de l'Union Française de l'Electricité à Paris !










