22 avril 2025
Réponse de l’UFE à la consultation publique sur le bilan prévisionnel 2025

Partie 1 : Cadrage général du BP 2025
Question 1 : Cadrage de l’étude
Partagez-vous les principaux enjeux de l’étude ? Voyez-vous d’autres enjeux qu’il serait souhaitable d’éclairer grâce au prochain Bilan prévisionnel ?
L’UFE partage les enjeux de l’étude, mettant en évidence l’intérêt d’un socle d’étude pour le paramétrage du mécanisme de capacité, la réalisation d’une analyse du besoin de flexibilités et l’étude d’un nouveau type de configuration.
A propos de l’analyse du besoin de flexibilités, l’UFE estime qu’elle doit permettre de caractériser les besoins de modulation (consommation et production), de qualifier le rôle stratégique des flexibilités dans le pilotage du système électrique. Les résultats du BP sur ce sujet pourront notamment servir à affiner les scénarios sur les flexibilités nécessaires au bon fonctionnement du système, de telle sorte à permettre aux différents acteurs d’identifier la contribution qu’il peut apporter à ces flexibilités, dans le strict respect de la neutralité technologique et sans distorsion de concurrence entre filières ou actifs.
L’UFE souligne l’importance de cette mise à jour du bilan prévisionnel, notamment pour paramétrer le prochain mécanisme de capacité. Outil essentiel et reconnu par la commission européenne comme un outil de marché à part entière, il est nécessaire pour la sécurité d’approvisionnement de la France d’avancer rapidement afin de mettre en place un nouveau mécanisme dès l’hiver 26-27.
A propos du paramétrage du mécanisme de capacité, l’UFE souligne que si RTE venait à utiliser ces calculs de missing money, il faudrait que les acteurs disposent d’éléments précis sur les méthodes utilisées. Par conséquent, il faudra que les projections de prix de marché réalisées par RTE fassent l’objet d’une grande transparence auprès des acteurs sur les hypothèses retenues (coûts des différentes technologies). L’UFE souligne l’incertitude quant à l’utilisation du scénario « A actualisé » ou le « D » pour la définition du besoin de capacité, et estime qu’une clarification serait nécessaire. L’UFE rappelle avoir pris position, dans sa consultation publique sur le mécanisme de capacité, sur l’importance de respecter rigoureusement la neutralité technologique dans le cadre de la définition du mécanisme.
L’UFE propose d’utiliser la révision de ce bilan prévisionnel pour identifier les indicateurs en amont de l’électrification, permettant de suivre et piloter la hausse nécessaire et à venir de la consommation d’électricité. Ces indicateurs pourront ainsi alimenter le tableau bord exigé dans la PPE 3 mis en consultation durant le mois de mars 2025.
Question 2 : Les scénarios
Partagez-vous l’approche proposée d’étudier deux scénarios principaux ? Si non, que proposez-vous ? Partagez-vous les principes de construction du nouveau scénario « D » ?
L’UFE partage l’intérêt de mettre à jour deux scénario au regard des tendances actuelles qui doivent être couvertes pour envisager la résilience du système électrique dans un contexte de transition énergétique.
Le dispositif d’étude est cohérent, avec le recours à deux cadres macroéconomiques, afin de mettre en lumière les conditions de réussite de la transition énergétique dans le scénario « A-actualisé », et les conséquences à anticiper lors d’un retard sur les évolutions de la consommation en identifiant les implications pour le système électrique dans le cas d’un scénario « D ».
Par ailleurs, l’UFE souligne que le scénario « D » permet d’augmenter la couverture du champ des possibles, qui nécessiterait des visions plus contrastées, tout en restant cohérentes et crédibles.
L’UFE comprend la nécessité d’étudier un scénario supplémentaire correspondant au « nouvel équilibre » du système électrique. Dans la mesure où l’évolution de la consommation d’électricité ne permet pas d’affirmer une tendance claire sur l’électrification des usages, l’étude d’un scénario fondé sur un rythme de croissance de la consommation d’électricité faible doit permettre d’identifier les leviers permettant de définir une politique de la demande en électricité.
Cependant, l’UFE souligne que le scénario « D » ne doit pas être interprété comme le plus probable. Au contraire, un tel scénario est indésirable et induirait un risque de désoptimisation du système électrique. Il devrait permettre d’évaluer les risques économiques et énergétiques associés à un sous-investissement dans la décarbonation, et d’objectiver les coûts de l’inaction. Par conséquent, l’UFE estime que l’électrification des usages, en incitant à consommer plutôt l’après-midi, et le pilotage du développement de l’offre (fixation des objectifs et pilotage dynamique) compte tenu du rythme effectif de développement de la demande, sont des outils indispensables à mettre en place. Ce scénario devrait notamment quantifier les impacts sur la balance commerciale énergétique, le coût de la dépendance accrue aux énergies fossiles et la perte de compétitivité industrielle. Il devra, en miroir, illustrer les bénéfices à piloter finement l’électrification des usages, afin d’éclairer les choix des pouvoirs publics sur des mesures efficaces à mobiliser pour atteindre les objectifs climatiques.
L’UFE suggère que soit étudiée une variante de ce scénario, avec une demande d’électricité stable (donc une électrification encore plus pessimiste) et une trajectoire de développement des EnR correspondant à la PPE3. L’UFE souligne que cette variante ne doit pas être considérée comme la référence du scénario « D », mais plutôt être utilisée afin d’évaluer les coûts du système électrique en cas de décorrélation des trajectoires d’offre et de demande. De plus, l’UFE estime que l’intégration des coûts de financements dans l’évaluation du coût du système électrique permettrait d’adopter une approche en coûts complets afin d’évaluer la pertinence économique d’un scénario.
Selon vous, quels principes de construction de ce scénario pourraient être envisagés au-delà de 2030 ?
Les « Futurs énergétiques 2050 » concluaient que la transformation du système électrique devait intégrer dès à présent les conséquences probables du changement climatique, notamment sur les ressources en eau ou les vagues de chaleur (déjà toutes deux constatés), or nous ne retrouvons plus cet aspect dans les principes de construction du scénario « D ».
Le dernier rapport du GIEC précise que le réchauffement climatique causé par l’activité humaine atteindra 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle dès les années 2030-2035, et le réchauffement qui s’en suivra jusqu’en 2050 doit être anticipé dans nos choix dès aujourd’hui.
Les « Futurs énergétiques 2050 » estimaient que celui-ci pouvait conduire à des baisses de production du parc nucléaire pouvant atteindre ponctuellement jusqu’à 6 GW, toutes choses égales par ailleurs, et des évolutions mineures de la production éolienne et solaire liées au changement climatique étaient identifiées. Ces sensibilités doivent être prises en compte dans l’étude du bilan prévisionnel 2035 qui guidera des choix d’investissements qui perdureront au-delà et illustrera l’intérêt en vue de mise en œuvre de leviers (réglementaires, organisationnels ou technologiques) pour minimiser ces impacts.
Partie 2 : Le cadrage macroéconomique
Question 3 : Les hypothèses économiques
La trajectoire de croissance du PIB retenue dans le cadre favorable du Bilan prévisionnel 2023 (+1,1%/an en moyenne à l’horizon 2035) vous semble-t-elle toujours pertinente comme base pour l’élaboration des scénarios du Bilan prévisionnel 2025 ?
Au vu des événements récents, d’un risque de guerre commerciale et des difficultés économiques et budgétaires rencontrées par la France, l’UFE souligne que l’hypothèse relative à la croissance économique est soumise à une incertitude particulièrement importante. Dès lors, l’UFE propose de cadrer les scénarios « A-ref» et « D » dans un contexte d’une mondialisation contrariée.
La différenciation des deux scénarios sur la base d’une hypothèse de réindustrialisation vous parait-elle cohérente avec les narratifs envisagés ? Un rebouclage macroéconomique de cette hypothèse sur la trajectoire de croissance économique vous parait-il opportun ?
Partie 3 : Hypothèses pour les perspectives d’évolution de la consommation d’électricité
Question 4 : consommation dans les bâtiments (hors datacenters)
S’agissant des secteurs résidentiel et tertiaire, partagez-vous la proposition d’étudier la même trajectoire d’évolution de la consommation dans les deux scénarios ? Disposez-vous d’éléments qui permettraient de les différencier ?
Considérant la forte incertitude portant sur cette hypothèse structurante du nombre annuel de rénovations, l’UFE suggère de considérer une trajectoire de rénovation plus crédible, qui reposerait sur un nombre de rénovations moins élevé mais dans laquelle les objectifs climatiques seraient atteints grâce à un transfert massif des logements chauffés aux énergies fossiles vers l’ensemble des énergies bas-carbone, principalement l’électricité. Cette trajectoire est détaillée dans l’étude de la filière électrique publiée en 2020[1].
Question 5 – consommation des datacenters
S’agissant des datacenters, estimez-vous que les trajectoires devraient être revues par rapport à la trajectoire du Bilan prévisionnel 2023 : par exemple, en vue de rehausser la trajectoire du scénario « A actualisé », soit baisser la trajectoire du scénario « D » ?
Au vu des volumes de raccordement évoqués, partagez-vous l’approche de RTE d’appliquer des prudences, en particulier concernant l’utilisation des puissances de raccordement demandées ? Les annonces du « Sommet pour l’action sur l’IA » de février 2025 vous semblent-elles de nature à rehausser ces perspectives de raccordement (des projets totalisant environ 3 GW ayant déjà été annoncés) ?
Question 6 – consommation des transports (hors hydrogène)
Pour la mise à jour du scénario « A », pensez-vous qu’il soit pertinent de maintenir le niveau d’électrification du secteur des transports à l’horizon 2035 étudié dans le cadre du scénario « A-référence » du BP2023, malgré le ralentissement observé sur les ventes de véhicules électriques en 2024 et le resserrement des aides ?
Aux vu des tendances européennes du début d’année 2025, l’UFE juge pertinent de maintenir un niveau d’électrification important du secteur des transport à l’horizon 2035.
En effet, bien que la discussion stratégique avec la commission européenne ait permis de relâcher la pression à court terme sur les constructeurs, les perspectives de croissances des véhicules électriques semblent bien enclenchées. Le nombre de modèles disponibles de voitures électriques est largement en hausse en 2025 par rapport à 2024 avec une nette hausse des offres de véhicules plus petits (Renault 5 ou 4, Volkswagen ID 2, …) et de véhicules sans permis (Citroën AMI et Mobilize Duo) permettant à un plus grand nombre d’accéder à l’électrique.
Bien que le marché des véhicules légers électriques accuse un retard par rapport aux objectifs (évolution de –20,5% au T1 2025 par rapport au T4 2024), l’électrification des véhicules utilitaire ou des poids lourds prend de l’ampleur en ce début d’année avec des augmentations à deux chiffres (respectivement +55% et +77% en janvier 2025). A propos des véhicules légers, de nouvelles réglementations touchant les entreprises entrent en vigueur concernant la fiscalité des véhicules de fonctions. Cette nouvelle réglementation devrait permettre de réhausser l’achat par les entreprises des véhicules légers. Enfin, le marché des véhicules électriques d’occasion connait un fort essor avec +38% au T1 2025 par rapport au T4 2024. Avec 80 129 véhicules électriques d’occasion vendus, le marché d’occasion se rapproche en volume du marché du neuf (94 111 véhicules électriques d’occasion).
Proposeriez-vous d’autres inflexions relatives au secteur du transport à prendre en compte dans l’un ou l’autre des scénarios ?
A la vue de la croissance attendue ci-dessus, le scénario « D » semble proposer un arrêt de l’électrification des véhicules léger jusqu’en 2026 et une augmentation avec une accélération faible. Même si une relance différée pourrait être pertinente dans ce scénario, il paraît plus opportun d’envisager une augmentation plus importante après 2026 au vu des nouvelles réglementations.
Question 7 – consommation de l’industrie et pour la production d’hydrogène
Que pensez-vous d’une révision à la baisse de l’ordre de 20 TWh à l’horizon 2030 au périmètre de ces deux secteurs pour la mise à jour du scénario « A » (130 TWh versus 150 TWh), et d’une baisse de l’ordre de 40 TWh pour le scénario « D » ?
La consommation d’électricité dans l’industrie sera conditionnée à la production d’hydrogène, à l’électrification des procédés et des besoins de chaleur et aux gains sur l’efficacité des procédés. Or, pour l’acier, l’évolution à la baisse de la production déjà prévue dans le précédent BP (-1,6 Mt d’acier/an) risque d’être plus importante dans un contexte économique actuel difficile : explosion des droits de douane par les USA, baisse de la demande d’acier et surcapacité de production entrainant la fermeture d’usines (par exemple à Reims et à Denain pour Arcelor Mittal) et le gel des investissements de décarbonation à Fos-sur-Mer et Dunkerque.
La production d’hydrogène doit permettre la décarbonation d’usages spécialisés à forte valeur ajoutée et non électrifiables directement dans l’industrie et les transports. Cependant, l’UFE constate les retards pris par les projets d’hydrogène et l’objectif affiché dans la stratégie nationale pour l’hydrogène décarboné de 6,5 GW de capacité installée (soit +50 TWh) à horizon 2030 ne sera vraisemblablement pas atteint. À fin 2024, on dénombre seulement 35 MW de capacités installées et 280 MW en construction ou ayant atteint la décision finale d’investissement.
L’UFE estime ainsi qu’il semble nécessaire de réviser à la baisse les objectifs de consommations d’électricité dans l’industrie et pour la production d’hydrogène à horizon 2030, et ce, pour les deux scénarios.
Question 8 – flexibilités de consommation
Pensez-vous réaliste de revoir à la hausse l’hypothèse de véhicules dont la recharge serait pilotée en V2G à l’horizon 2030 ?
Le pilotage de la recharge tarifaire (sur les heures creuses) des véhicules électriques permet d’éviter des appels de puissance inopportuns et incite ainsi les acteurs à innover pour encourager les conducteurs, à condition qu’ils y trouvent un avantage sans se sentir contraints.
Par ailleurs, vu les évolutions rapides et les annonces de nouveaux modèles de segment B intégrant des possibilités de V2H ou V2G (Renault 5, Volkswagen ID 2), l’UFE juge opportun de réévaluer à la hausse le nombre de véhicule adoptant et utilisant cette technologie à horizon 2030 et 2035. Ainsi, une part d’au moins de 2% en 2030 de la flotte semble raisonnable.
Partagez-vous l’hypothèse de baisse de la flexibilité des électrolyseurs sur le court terme ?
Partie 4 : Hypothèses pour les perspectives d’évolutions de la production d’électricité
Question 9 – production nucléaire et contraintes d’exploitation
A tous – partagez-vous la reconduction de l’hypothèse prudente d’un productible nucléaire de 360 TWh à moyen terme et d’une variante plus haute de disponibilité visant une production de l’ordre de 380-400 TWh ?
L’UFE est alignée avec les hypothèses proposées par RTE.
Question 10 – énergies renouvelables
Dans le cadre de la mise à jour du scénario « A », partagez-vous la proposition de reconduire les hypothèses du scénario « A-ref » du BP2023 cohérentes avec les ambitions affichées dans la PPE en consultation (à l’exception du solaire) ? S’agissant du photovoltaïque en particulier, quelles trajectoires vous semblent devoir être considérées en référence ?
L’UFE partage les hypothèses sur le développement de l’éolien en mer, soit 3,6 GW en 2030 et 18 GW en 2035.
L’UFE propose de considérer la fourchette haute de 45GW d’ici 2035 et donc de prendre en compte un rythme de développement de 2 GW/an additionnels pour l’éolien terrestre afin de respecter les objectifs de décarbonation, et soutenir les filières industrielles françaises et européennes, dans le prolongement du « paquet éolien » de la Commission européenne. Retenir un rythme de 1,5 GW/an revient à considérer la fourchette basse de 40 GW d’ici 2035 de la PPE 3, sans prendre en compte le gain potentiel des projets renouvelés. Or le renouvellement des projets éoliens terrestres viendra contribuer aux objectifs en termes de puissance nette supplémentaire, mais aussi en termes de productivité (davantage de MWh/MW installé). Le chiffrage de ce gain reste difficile tant les conditions de renouvellement sont spécifiques à chaque projet. Il sera important de suivre collectivement et avec précision ce segment de marché.
S’agissant du photovoltaïque, l’UFE propose de retenir pour hypothèse la reconduction du rythme de développement de la trajectoire de référence du BP2023 (un rythme minimum de 4 GW/an dès 2025 sur l’ensemble des segments pour assurer le développement des entreprises et leur capacité de croissance, et pour que cette filière puisse être une variable d’ajustement à la hausse, en cas d’aléa sur d’autres filières de production).
A propos du développement de l’hydroélectricité, l’UFE propose de retenir un rythme d’augmentation des capacités de 2,8 GW dont 1,7 GW de STEP à l’horizon 2030-2035.
Pour la définition du nouveau scénario « D », partagez-vous les propositions d’une prolongation du rythme actuel pour le solaire et l’éolien terrestre, et d’une vision prudente sur l’éolien en mer ? Considérez-vous que des rythmes spécifiques devraient être étudiés sur la période 2030-2035 ?
Pour le solaire, il semble pertinent de maintenir à minima la tendance actuel (à environ 4GW/an)[2] qui pourrait se maintenir dans le cadre du nouveau S21. Cependant, dans un scénario où la consommation n’augmenterait pas, il semble pertinent d’étudier un scénario avec un ralentissement de ce rythme du fait de moindres opportunités de marché pour les développeurs de projet et d’évolution des orientations en matière de soutien public.
Concernant l’éolien, la tendance actuelle de l’ordre de 1 à 1,5GW/an semble pertinent à étudier jusqu’à 2035.
Enfin pour l’éolien en mer, il semblerait opportun d’étudier l’impact d’un décalage dans le temps des nouveaux parcs. L’UFE recommande une approche prudente de l’ordre de 10 à 12 GW en 2035.
L’UFE estime pertinent d’étudier une variante au scénario « D » qui porterait sur des trajectoires « contradictoires », combinant une hausse de l’offre et baisse/stagnation de la demande, afin d’évaluer les conséquences d’un système surcapacitaire. Dans ce cadre, il serait intéressant de pouvoir apprécier l’impact sur le système électrique d’un rythme de développement du PV visant 90 GW en 2035 par rapport à 65 GW, et de l’éolien terrestre atteignant 45 GW en 2035 par rapport à 40 GW (ce dernier étant considéré comme un rythme « plancher »).
Question 11 – parc thermique
Aux exploitants : avez-vous de nouvelles perspectives de fermeture, prolongation de vos moyens de production (durée de vie envisagée, projet de modification du combustible principal, principaux jalons décisionnels) ?
Dans quelles mesures les projets de décarbonation des sites hébergeant certains moyens thermiques pourraient conduire à leur fermeture ? Selon quel calendrier ?
Quelles trajectoires vous sembleraient pertinentes d’étudier sur l’évolution de la capacité installée des cogénérations au gaz (amplitude des risques de fermetures à considérer) ?
A tous : avez-vous des projets de développement de nouveaux moyens de production ne fonctionnant pas aux combustibles fossiles ?
Question 12 – batteries
Selon vos modèles d’affaires, pensez-vous que d’autres hypothèses devraient être considérées sur le développement des batteries ? A la lumière de vos projets de développement de batteries, partagez-vous ces hypothèses sur les tailles/durées des batteries à considérer ?
L’UFE souligne que, en pratique dans le cadre actuel, une batterie n’est pas restreinte dans un service spécifique et se positionne sur plusieurs marchés pour optimiser son fonctionnement (« revenu stacking »). Une batterie maximise ses revenus en se diversifiant sur les différents marchés où elle peut se positionner.
Les batteries de 2 h ne sont pas exclusivement destinées à participer aux Services Systèmes : elles peuvent aussi, par exemple, participer à des marchés en énergie, ou le moment venu à de la flexibilité locale.
Partie 5 : Hypothèses sur les interconnexions et l’évolution de la consommation, de la production à l’échelle européenne
Question 13 – hypothèses européennes
Que pensez-vous des ajustements proposés sur les hypothèses européennes pour la construction et l’étude du scénario « D » ?
L’UFE suggère de prendre comme référence la situation actuelle des interconnexions existantes avec les pays voisins, en tenant compte de celles en cours de construction ou sur le point d’être validées pour construction. Toute interconnexion future devrait être déterminée sur la base d’une analyse distincte, prenant en compte la complémentarité des mix énergétiques, les écarts de prix et d’autres facteurs pertinents.
Partie 6 : Hypothèses pour les analyses économiques et le paramétrage du mécanisme de capacité : hypothèses de prix des commodités et des coûts des technologies
Question 14 – hypothèses de coûts
Disposez-vous d’éléments nouveaux permettant de déterminer les coûts réels de fonctionnement de vos moyens de production existants, en particulier ceux à risque de fermeture en l’absence de rémunération capacitaire ?
Batteries – Selon vous, les hypothèses de coûts de développement des batteries devraient-elles être mises à jour depuis le BP2023 ? Quelle taille de batteries prévoyez-vous majoritairement de développer (en nombre d’heures de stock) ?
Thermique – quels sont les coûts des projets de nouvelles centrales thermiques décarbonées, ou de conversion de centrales existantes (CAPEX et OPEX fixes et variables) ?
Flexibilités de consommation – Quels coûts préconisez-vous de retenir pour la mise en place des flexibilités de consommation en fonction du gisement mobilisé, des secteurs (industriel, résidentiel, tertiaire) et du type d’effacement (pilotage tarifaire, pilotage dynamique, valorisé de façon implicite ou explicite) ?
Coûts du capital – Comment les évolutions récentes du taux sans risque ont impacté vos coûts de financement ? Dans le cadre précis des projets d’investissement en lien avec le mécanisme de capacité, quel niveau de coût de capital anticipez-vous en fonction de la durée des contrats pluriannuels ? (préciser, par exemple et si pertinent, la structure des financements envisagés, les coûts associés ainsi que les décompositions entre taux sans risque et primes de risque)
Question 15 – hypothèses de projection des prix des commodités
Prix des combustibles – Vous semble-t-il pertinent de reconduire les hypothèses de prix des combustibles retenues dans le cadre macroéconomique favorable du BP2023 ? Quelles analyses de sensibilités jugez-vous nécessaire d’étudier ?
La proposition actuelle suppose uniquement une dynamique baissière des prix du gaz. Il serait souhaitable de tester également un scénario avec des prix du gaz plus élevés et d’évaluer la réponse du système à cette situation. Le WEO 2024 pourrait être utilisé à cette fin.
Prix du CO2 – La différenciation de l’hypothèse de prix du CO2 entre les deux scénarios vous parait-elle cohérente avec les narratifs envisagés ? Pensez-vous nécessaire d’étudier des analyses de sensibilités supplémentaires sur le prix du CO2, si oui lesquelles ?
Question 16 – autres hypothèses liées à la projection des revenus
Revenus complémentaires – Selon vos modèles d’affaires, quels revenus perçus sur les autres marchés (e.g., infrajournalier, réserves, services système, chaleur, etc.) seraient à intégrer à l’analyse de rentabilité économique (en €24/kW/an pour vos différents moyens de production et stockage) ?
Aversion au risque – L’hypothèse d’une aversion au risque affectant les anticipations des revenus issus des marchés de l’énergie vous semble-t-elle fondée ? Si oui, validez-vous sa modélisation via l’utilisation d’une CVaR avec un seuil de 90 % ?
[1] https://ufe-electricite.fr/la-filiere-electrique-publie-son-etude-lelectricite-au-coeur-du-batiment-performant-au-service-de-lusager-une-reponse-aux-enjeux-energetique-climatique-et-numerique/
[2]L’opendata d’Enedis montre qu’en 2024 4,6 GW d’installations solaires ont été raccordées et mises en service sur le réseau de distribution géré par Enedis.


Réponse de l'UFE à la consultation publique RTE sur le bilan prévisionnel 2025
pdf (278,92 Ko)
L'observatoire de l’industrie électrique en parle
observatoire-electrique.fr

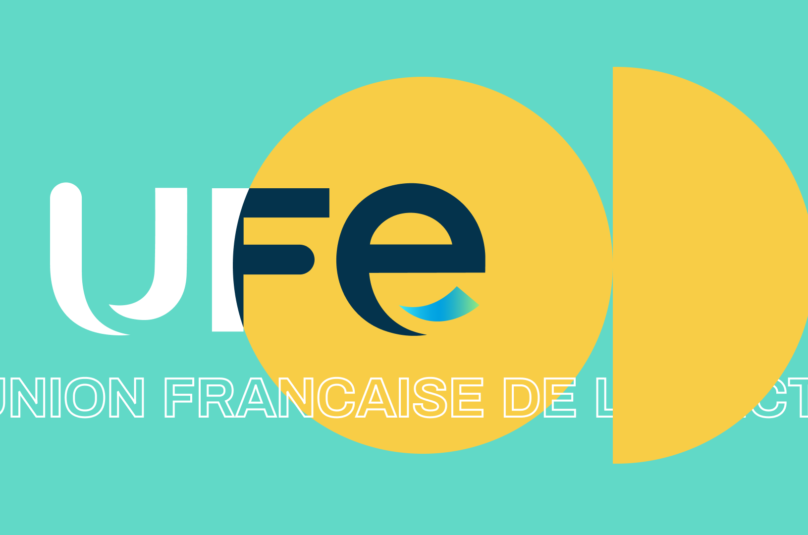
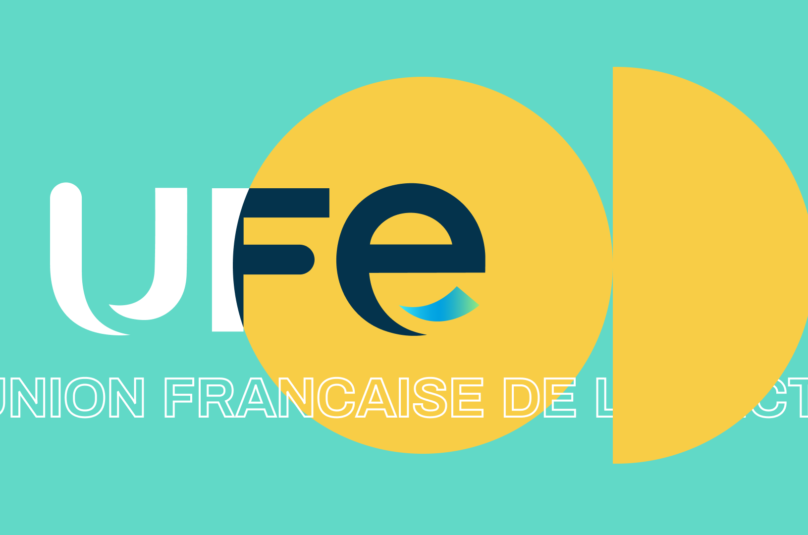
Présentation de l'UFE
L’Union Française de l’Électricité est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle représente les entreprises de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur électrique français : producteurs de toutes technologies, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’électricité et de services d’efficacité énergétique, en passant par les opérateurs de stockage et du pilotage des consommations.
en savoir +Evènements du secteur






Colloque UFE


Colloque 2026
Colloque de l’Union Française de l’Électricité
Le mardi 23 juin 2026 se tiendra la 14ème édition du Colloque de l'Union Française de l'Electricité à Paris !











