06 novembre 2025
Participation de l’UFE à la Conférence nationale de l’eau
L’Union Française de l’Électricité est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle représente les producteurs d’électricité dans la gouvernance de l’eau par bassin hydrographique, toujours dans une logique de gestion équilibrée et durable. L’UFE est engagé à promouvoir un modèle efficace de gouvernance par concertation et recherche de consensus, nécessaire à la préservation de la ressource en eau et au partage équilibré entre usages, dont la production d’énergie.
L’UFE soutient en France une politique de partage de l’eau construite autour des 3 principes :
- L’eau est un bien commun dont nul n’est propriétaire,
- La gouvernance est organisée par bassin versant, vallée ou sous-bassin,
- Les pouvoirs publics, en tant que garant de l’intérêt général, sont au cœur du dispositif et arbitrent en dernier ressort notamment en cas de conflit entre usages (notamment pour préserver les enjeux essentiels en matière d’énergie).
Dans le cadre des réflexions en cours et alors que la représentation du monde économique est de plus en plus diluée, l’UFE défend une meilleure représentation des acteurs économiques qui sont d’importants contributeurs de la politique de l’eau en France.
Par ailleurs, l’UFE appelle de ses vœux des moyens alloués aux différents collèges au sein des Comités de Bassin pour mieux suivre les différentes évolutions à la fois des réglementations, mais aussi des enjeux sur la ressource en lien avec le changement climatique.
Requestionner la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE) en France à la lumière des enjeux de changements climatiques
Comme l’a pointé le Ministère de la Transition Écologique – dans sa commandite datée du 25 février 2025 à l’Office française de la biodiversité (OFB) d’une étude des progrès réalisés en France concernant l’état des eaux -, les états des lieux à date n’illustrent pas les efforts réalisés ni ne reflètent les progrès effectivement obtenus ces dernières années : en cause, les indicateurs évolutifs au fil du temps, qui fait que certains gains environnementaux espérés via les programmes de mesures se révèlent insuffisants pour changer de classe de qualité, …
Face à une situation qui pourrait amener la France à être pointée en manquement par la Commission Européenne en 2027, l’UFE propose une approche plus pragmatique de mise en œuvre de la DCE, fondée sur l’efficacité réelle et prouvée des actions engagées. Pour cela, il importe pour le prochain schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le prochain programme de mesures de :
- tirer le retour d’expérience des SDAGE et programmes des mesures (PDM) précédents, se concentrer sur les masses d’eau restant en difficulté en leur appliquant les mesures qui ont prouvé leur efficacité et abandonner les mesures qui n’ont qu’un intérêt théorique ou marginal, dont souvent le seul argument est qu’elles « ne peuvent pas faire de mal » ;
- savoir prioriser nos efforts et revoir éventuellement localement les ambitions (notamment lorsqu’il s’agit de préconiser des mesures sur des masses d’eau déjà en bon état) pour privilégier l’affectation optimale des moyens au profit du plus grand nombre de masses d’eau et de la plus grande efficacité ;
- prendre en compte le changement climatique dans les cibles de bon état / de bon potentiel à atteindre ;
- s’interroger sur la dimension hydromorphologique des états des lieux et l’efficacité des mesures associées généralement dans les PDM, au même titre que cela est prévu dans l’étude de progrès demandée par le MTE à l’OFB pour la physico-chimie. L’étude MTE-OFB ne traite en effet pas la dimension hydromorphologique ni la question des « polluants spécifiques » alors que l’état des masses d’eau ne peut être traité en « silo » et résulte de multiples paramètres. L’argument sous-tendant cette exclusion de l’hydromorphologie est que celle-ci est examinée seulement pour passer de bon état à très bon état : ce qui est alors contradictoire avec l’affirmation répétée qu’elle est une des principales pressions nuisant à l’atteinte du bon état (ce qui justifie ensuite un certain nombre de mesures hydromorphologiques). Les 2 composantes hydromorphologie et polluants spécifiques nous semble devoir être réintroduites dans l’étude de progrès.
Repenser l’eau comme un pilier structurant de l’aménagement du territoire
Depuis la Directive Cadre sur l’Eau (2000), les cibles mises en avant dans les bassins et les efforts associés se sont focalisés sur l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau. Ce socle environnemental reste essentiel, mais à l’heure du changement climatique, des tensions accrues sur la ressource et du nécessaire renforcement de la résilience des territoires, il nous semble que la gestion de l’eau doit être appréhendée comme vecteur indispensable et pilier structurant de l’aménagement du territoire et de son développement économique.
Concrètement, cela implique notamment :
- Une reconnaissance plus forte du rôle stratégique des infrastructures hydrauliques (barrages, canaux, … mais aussi zones humides restaurées, …) dans l’équilibre des territoires et des usages
- Un pilotage renforcé des politiques de l’eau à l’échelle du bassin pour assurer le développement territorial
- Une logique de mutuelle / assurance à développer par les Agences de l’eau dans leurs modalités d’interventions pour faire face aux aléas climatiques et aux coûts d’adaptation.
Ainsi, les axes des SDAGE post 2027 et, par voie de conséquence, les priorités données aux agences de l’eau doivent évoluer pour mettre en avant le A (aménagement) de SDAGE, intégrer pleinement cette ambition d’eau aménageuse du territoire et orienter les moyens des agences de l’eau vers des projets réellement transversaux d’aménagement des territoires.
Poursuivre les efforts de soutien financier aux actions de sobriété
Les efforts de sobriété encouragés dans le Plan Eau national doivent être poursuivis et bénéficier des aides des Agences de l’eau dans le souci du coût / efficacité vis-à-vis de la rareté actuelle / future de l’eau. En déclinaison du plan de sobriété hydrique de la filière nucléaire[1], l’UFE soutient les actions visant à une meilleure prise en cause de ces enjeux de l’eau. L’UFE en lien avec les autres syndicats professionnels soutient les actions visant à une meilleure prise en compte de ces enjeux de l’eau.
Renforcer l’approche par le grand cycle de l’eau, porteuse de gains collectifs
Une priorité est à accorder aux contributions positives au grand cycle de l’eau visant à redonner aux écosystèmes leurs rôles de régulation et ralentissement du cycle de l’eau : limiter le ruissellement, favoriser l’infiltration et le stockage dans les sols et les nappes…
Ainsi, l’UFE est particulièrement favorable aux projets qui traitent de manière combinée les enjeux du nexus eau / biodiversité / carbone et privilégient des options de type Solutions Fondées sur la Nature (restauration de ripisylves, de zones humides, préservation de forêts…). Les zones humides, en particulier, doivent jouer un rôle important car elles constituent des moyens « naturels » d’infiltration et de stockage, de tampon pour les périodes de crues et peuvent permettre d’améliorer la qualité de l’eau.
Pour atteindre un effet d’échelle, les démarches collectives à l’échelle des bassins versants sont à renforcer, privilégier et encourager.
Mais, l’approche par le grand cycle de l’eau doit aussi intégrer les aspects essentiels aux territoires qu’ils soient économiques, énergétiques ou alimentaires (cf. la logique d’aménagement évoquée supra). Ainsi, la notion de nexus porte en elle la reconnaissance que l’eau est à la fois une ressource vitale et un levier stratégique indispensable à des activités essentielles de la nation : production d’énergie, alimentation, emploi…
Adapter les modèles économiques à la réalité des effets du changement climatique
Les producteurs d’énergie sont déjà très fortement contributeurs à la politique de l’eau
Les producteurs d’énergie participent de manière significative au financement des politiques de l’eau. Le niveau de redevances payées aux agences de l’eau a fortement augmenté avec le Plan eau de 2023 et ce niveau est appelé à croître du fait de l’indexation des taux planchers sur l’inflation.
Au-delà de cette contribution financière, les parcs hydroélectriques assurent des missions d’intérêt général en contribuant activement à la gestion de la ressource en eau et à la lutte contre le dérèglement climatique : deux tiers de ses aménagements assurent aujourd’hui des missions complémentaires à leur vocation première de production d’énergie flexible et de pointe : soutien d’étiage (eau potable, milieux aquatiques, irrigation…), facilitation des activités sur les plans d’eau par le maintien de cotes estivales…. au cours de périodes de sécheresse qui se font de plus en plus fréquentes et longues.
Reconnaître et financer les services environnementaux
Parmi les leviers à envisager pour favoriser les actions sur le grand cycle de l’eau contribuant à la régulation du trop et du trop peu d’eau (services écosystémiques), figure probablement le paiement pour services environnementaux. Ce mécanisme doit pouvoir bénéficier à tout type de maître d’ouvrage (acteur socio-économique : industriel, agriculteur, collectivité, …) afin de rendre ces initiatives financièrement soutenables.
Mieux organiser la solidarité de bassin, voire entre bassins
Les périmètres pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) montrent leurs limites et sont potentiellement inadaptées pour soutenir des actions bénéficiant à l’ensemble d’un bassin versant (efforts d’aménagement menés à l’amont bénéficiant aux communes aval). Pour favoriser les projets de l’amont bénéficiant à l’aval, il est certainement nécessaire de promouvoir plus encore une solidarité y compris financière à l’échelle du bassin et, dans certains cas de figure, en inter-bassins.
Adapter les processus de préparation des SDAGE aux enjeux climatiques
Le processus actuel d’élaboration du SDAGE apparaît long et peu adapté à l’accélération des phénomènes liés au changement climatique. Face à une urgence croissante en matière d’atténuation et d’adaptation, les acteurs de l’eau expriment un besoin fort d’agir rapidement. Or, cette urgence contraste avec le rythme des cycles de révision du SDAGE.
À titre d’exemple, les États des lieux (EDL) réalisés dans les bassins reposent sur des données de fin 2023, alors que le SDAGE correspondant ne sera mis en œuvre qu’entre 2028 et 2033. Cette temporalité interroge la pertinence du dispositif actuel.
Par ailleurs, les Programmes d’Actions Opérationnels Territoriaux (PAOT) des SDAGE en cours comportent de nombreuses actions, dont les taux d’avancement restent faibles. Cette situation soulève une double interrogation :
- Est-ce uniquement lié à une capacité limitée à mettre en œuvre les actions ?
- Ou bien certaines actions sont-elles jugées non prioritaires par les acteurs concernés ?
- Dans ce contexte, ne conviendrait-il pas d’engager une réflexion sur l’évolution des travaux stratégiques dans les bassins ? Cette réflexion pourrait viser :
- Une redéfinition régulière des priorités d’action, fondée sur des connaissances actualisées des impacts du changement climatique ;
- L’intégration explicite de l’adaptation au changement climatique comme priorité transversale dans les bassins.
Recommandations de l’Union Française de l’Électricité
Dans plusieurs bassins, l’Etat des Lieux du SDAGE en cours d’élaboration a conduit à une aggravation du niveau de pression de certaines masses d’eau, en lien avec des aménagements hydroélectriques. Pourtant, ces aménagements ont fait l’objet d’actions en faveur du bon état des masses d’eau dans les PAOT précédents (continuité écologique, restaurations sédimentaires…). La justification avancée repose sur le principe selon lequel toute masse d’eau comportant un aménagement hydroélectrique est considérée comme soumise à une pression hydromorphologique, entraînant un Risque de Non Atteinte du Bon État (RNABE). Toutes ces masses d’eau sont alors concernées par des mesures.
Face à cette approche, les producteurs hydroélectriciens formulent les recommandations suivantes :
- Exclure du risque NABE les pressions pour lesquelles toutes les mesures ERC (Éviter, Réduire, Compenser) ont été mises en œuvre;
- En conséquence, ne plus considérer systématiquement l’hydroélectricité comme une pression nécessitant impérativement des mesures pour les masses d’eau en bon état ;
- Réévaluer les masses d’eau en bon état depuis plusieurs cycles, afin qu’elles ne soient plus soumises à des pressions artificielles ;
- Ne pas classer en RNABE les masses d’eau en bon état depuis plusieurs cycles, sauf en cas de modification significative des usages ou des caractéristiques ;
- Valoriser les actions et investissements réalisésdans le cadre du processus d’élaboration du SDAGE et du Plan de Gestion (PdM) ;
- Reclasser, le cas échéant, les masses d’eau en Masses d’Eau Fortement Modifiées (MEFM) avec des Objectifs de bon potentiel adaptés à la réalité.
[1] Elaboré par le Comité Stratégique de Filière Nucléaire – fév 2024


Participation de l’UFE à la Conférence nationale de l’eau
pdf (326,12 Ko)
L'observatoire de l’industrie électrique en parle
observatoire-electrique.fr

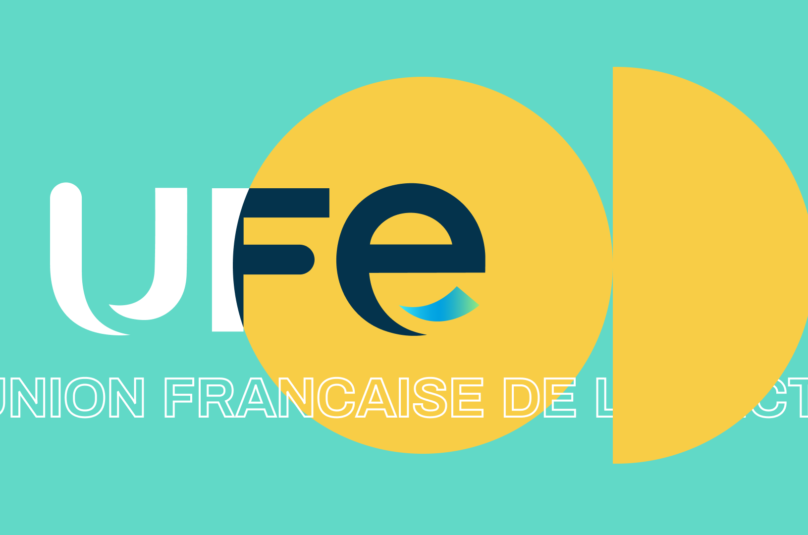
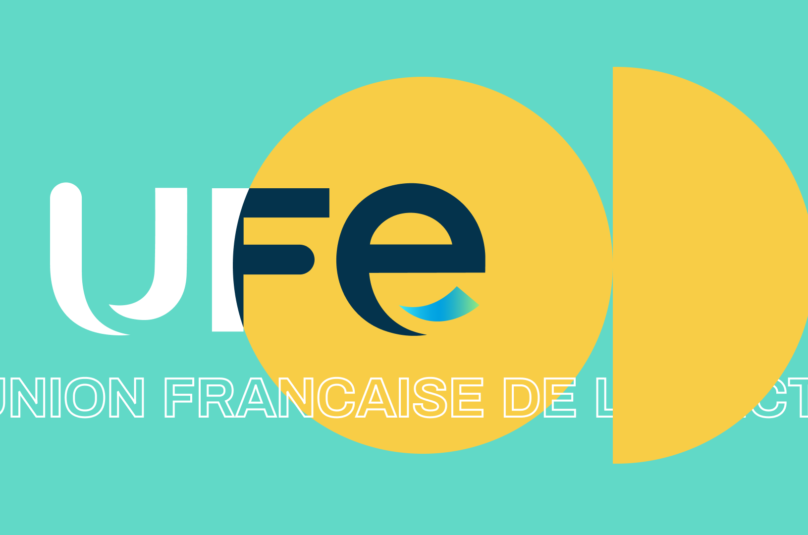
Présentation de l'UFE
L’Union Française de l’Électricité est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle représente les entreprises de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur électrique français : producteurs de toutes technologies, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’électricité et de services d’efficacité énergétique, en passant par les opérateurs de stockage et du pilotage des consommations.
en savoir +Evènements du secteur






Colloque UFE


Colloque 2026
Colloque de l’Union Française de l’Électricité
Le mardi 23 juin 2026 se tiendra la 14ème édition du Colloque de l'Union Française de l'Electricité à Paris !









